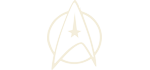Curiosity photos Mars
L’exploration de Mars par Curiosity est le déroulement de la mission du rover de Mars Science Laboratory développé par la NASA sur la planète Mars après son atterrissage dans le cratère Gale le 6 août 2012. Le véhicule dispose de 75 kg d’équipements scientifiques et a pour objectif de déterminer si l’environnement martien a dans le passé permis l’apparition de la vie.
La mission se décompose en trois phases :
– elle commence par une phase d’approche qui dure deux ans (août 2012 – septembre 2014), au cours de laquelle le rover parcourt 9 km et effectue des études géologiques lors de quatre arrêts prolongés : Yellowknife Bay, Darwin, Cooperstown et Kimberley ;
– lors de la deuxième phase, qui dure deux ans et demi (septembre 2014 – avril 2017), Curiosity parcourt 7 km. Il est progressivement dirigé vers les Bagnold Dunes, un long couloir d’épaisses dunes sableuses qui le sépare du Mont Sharp ; plus exactement vers l’endroit le plus étroit de ce couloir et a priori franchissable. De nouveaux arrêts prolongés sont organisés : Parhump Hills, les premières Bagnold dunes (notamment, en décembre 2015, la spectaculaire Namib Dune, de 4 mètres de haut), le plateau Naukluft, les Murray Buttes… jusqu’à ce fameux passage étroit où le sable ne recouvre que superficiellement le sol, ce qui permet à Curiosity d’amorcer la troisième et dernière phase de sa mission ;
– fin avril 2017 débute la phase décisive : Curiosity quitte les Bagnold dunes et amorce l’ascension du Mont Sharp. Le conduire à son sommet (situé à 5 km de là) lui permettrait d’avoir une vue d’ensemble du cratère Gale, qui mesure 150 km de diamètre et au centre duquel il se situe. Mais l’objectif premier se situe au pied de la montagne, dans la partie inférieure d’une vallée alluvionnaire, susceptible d’apporter le plus d’informations sur le passé du site.
Ayant parcouru 19 km en mai 2018, Curiosity est en bon état, malgré des roues superficiellement endommagées sur des terrains accidentés et qui contraignent parfois les techniciens du JPL à modifier le trajet initialement prévu. Un deuxième handicap est l’indisponibilité de la foreuse que les équipes au sol tentent de contourner depuis novembre 2016.
Le rover Curiosity est cinq fois plus lourd que ses prédécesseurs, les Mars Exploration Rovers (MER), ce qui lui permet d’emporter 75 kg de matériel scientifique, dont deux mini-laboratoires permettant d’analyser les composants organiques et minéraux ainsi qu’un système d’identification à distance de la composition des roches reposant sur l’action d’un laser. Les laboratoires embarqués sont alimentés par un système sophistiqué de prélèvement et de conditionnement d’échantillons comprenant une foreuse. Pour répondre aux besoins accrus d’énergie et s’affranchir des contraintes de l’hiver martien et des périodes nocturnes, le rover utilise un générateur thermoélectrique à radioisotope qui remplace les panneaux solaires mis en œuvre par les précédentes missions. Enfin, il bénéficie de logiciels évolués pour naviguer sur le sol martien et exécuter les tâches complexes qui l’attendent. Le rover est conçu pour parcourir 20 km et peut gravir des pentes de 45°.

La tempête de poussière martienne se développe à l’échelle mondiale de la planète Mars : le Rover Curiosity a capté quelques photos d’épaississement dues à la Brume. Une tempête de minuscules particules de poussière a englouti une grande partie de Mars au cours des deux dernières semaines et a incité le rover Opportunity de la NASA à suspendre ses opérations scientifiques. Mais à travers la planète, le rover Curiosity de la NASA, qui a étudié le sol martien à Gale Crater, devrait rester largement épargné par la poussière. Alors que Opportunity est alimenté par la lumière du soleil, qui est effacé par la poussière à son emplacement actuel, Curiosity a une batterie à énergie nucléaire qui fonctionne jour et nuit. La tempête de poussière martienne a pris de l’ampleur et est maintenant officiellement un événement poussiéreux «planétaire» (ou «global»).
La Nasa a découvert des molécules organiques complexes sur Mars
Le rover Curiosity de la NASA a foré un trou de cinq centimètres de profondeur dans une roche martienne dans le cadre de ses examens de la composition du sol de la planète rouge.
Plus le temps passe, plus il est facile de perdre de vue un fait étonnant : depuis 2012, des Hommes conduisent un véhicule scientifique de la taille d’un SUV sur une autre planète.
Cette merveille d’ingénierie, le rover de la NASA répondant au doux nom de Curiosity, a révolutionné notre compréhension de la planète rouge. Et grâce à ce rover intrépide, nous savons désormais que Mars présentait par le passé des composés à base de carbone appelés molécules organiques – des matières premières essentielles pour la vie telle que nous la connaissons.
Une nouvelle étude publiée dans le magazine scientifique Science présente la première preuve concluante de la présence de grandes molécules organiques à la surface de Mars, une poursuite qui a commencé avec le programme Viking de la NASA dans les années 1970. Des essais antérieurs avaient certes déjà suggéré l’existence de composés organiques, mais la présence de chlore dans la terre martienne rendait partiellement irrecevables ces interprétations.
« Lorsque vous travaillez avec l’instrument le plus complexe jamais envoyé dans l’espace, il est possible d’accomplir ce que l’on croyait auparavant impossible », explique Jennifer Eigenbrode , biogéochimiste au Goddard Space Flight Center de la NASA. « Je travaille avec des personnes incroyables sur Mars, et nous avons déjà découvert tellement de choses. »
Les dernières données envoyées par Curiosity révèlent que l’eau qui remplissait le cratère Gale sur la planète rouge contenait des molécules organiques complexes il y a environ 3,5 milliards d’années. Des traces de certaines molécules ont été conservées dans des roches sulfurées provenant de sédiments lacustres. La présence de soufre a peut-être permis de protéger les matières organiques même lorsque les roches ont été exposées à la surface à des radiations et à des substances semblables à de l’eau de javel appelées perchlorates.
En eux-mêmes, ces nouveaux résultats ne sont pas une preuve de vie ancienne florissante sur Mars ; des processus non vivants auraient pu favoriser le développement de molécules identiques. Au minimum, l’étude montre comment des être vivants auraient pu survivre pendant des éons – si toutefois ils ont jamais existé – et laisse entrevoir les chemins que pourront emprunter Curiosity et les rovers qui lui succéderont.
« C’est une découverte importante », explique Samuel Kounaves, un chimiste de l’Université Tufts et ancien scientifique en chef de l’atterrisseur Phoenix Mars de la NASA. « Il y a des endroits, surtout en subsurface, où les molécules organiques sont bien conservées ».
LA SAISON DU MÉTHANE
En plus des traces de carbone, Curiosity a capté des bouffées de matières organiques encore présentes sur Mars aujourd’hui. Le rover a périodiquement sondé l’atmosphère de Mars depuis son atterrissage, et à la fin de l’année 2014, les chercheurs utilisant ces données ont montré que le méthane – la molécule organique la plus simple – était présent dans l’atmosphère de Mars.
La présence de méthane sur Mars est déroutante, car il ne survit généralement que quelques centaines d’années, ce qui signifie que quelque chose sur la planète rouge lui permet de se régénérer sans cesse. « C’est un gaz dans l’atmosphère de Mars qui ne devrait vraiment pas être là », explique Chris Webster, scientifique de la NASA travaillant au Jet Propulsion Lab.
En outre, le comportement observé du méthane sur Mars est étrange. En 2009, les chercheurs ont signalé que des panaches martiens inexplicables éructaient au hasard des milliers de tonnes de méthane à la fois.
La dernière étude de Webster, également publiée dans Science, montre que Mars « respire » de façon saisonnière. Chaque été martien, la concentration de méthane de l’atmosphère s’élève à environ 0,6 partie par milliard. En hiver, ce chiffre est divisé par trois pour atteindre 0,2 parties par milliard.
« Nous n’observons pas de variations saisonnières des nombreuses molécules composant l’atmosphère terrestre, alors étudier une planète présentant des variations chimiques saisonnières nous emmène au-delà de nos connaissances », explique Eigenbrode. « C’est une observation stupéfiante. »
Webster et ses collègues émettent l’hypothèse que le méthane provient du sous-sol profond de la planète et que les variations de températures à la surface de Mars réduisent son débit vers le haut. En hiver, le gaz pourrait être emprisonné sous terre dans des cristaux de glace appelés clathrates, qui pourraient fondre en été et libérer le dit gaz.
Mais quel constituant de la planète peut-il bien produire du méthane? Personne ne le sait.
« Nous ne pouvons pas vraiment dire si ce méthane que nous voyons aujourd’hui est un produit actuel de serpentinisation [une réaction chimique entre les roches contenant du fer et de l’ eau liquide] ou est le résultat d’une activité microbienne à une certaine profondeur », explique Michael Mumma, le scientifique de la NASA qui a découvert les panaches de méthane sur Mars. « Ou est-ce un élément stocké depuis des millénaires qui est lentement et périodiquement libéré ? »
À LA RECHERCHE DE VIE EXTRATERRESTRE
Les experts saluent ces deux nouvelles études comme de nouveaux jalons dans l’histoire de l’astrobiologie.
« C’est incroyablement excitant, car cela montre que Mars est une planète active encore aujourd’hui », explique Bethany Ehlmann, un scientifique planétaire de Caltech, un expert de la planète rouge qui n’a pas pris part à ces études. « La planète n’est ni froide ni morte. Elle est peut-être juste à la limite de l’habitabilité. »
Les roches bordent un ancien chenal où l’eau a jadis coulé sur Mars.
Mais Webster et d’autres soulignent que les résultats des études eux-mêmes ne constituent pas la preuve de la vie sur Mars : « Les observations qui ont été faites n’excluent pas la possibilité d’une activité biologique, [mais] ce n’est pas une conclusion catégorique. »
Pour obtenir des réponses plus précises, les chercheurs devront fournir à Mars un équipement suffisamment sensible pour détecter un soupçon de vie dans la composition chimique du sol ou de l’atmosphère de la planète. Sur Terre, la vie produit plus de méthane et moins d’éthane que les réactions non vivantes. Si les chercheurs observaient cette signature sur Mars, les arguments en faveur de la présence de vie se renforceraient.
Les futures missions participeront à lever ce voile. Le vaisseau spatial ExoMars de l’Agence Spatiale Européenne, qui devrait se poser sur la planète rouge en 2020, pourra forer plus de deux mètres de profondeur dans des sols martiens immaculés et examiner des échantillons prélevés. Et le robot Mars 2020 de la NASA est lui prévu pour prélever des échantillons du sol martien lors des futures missions avant de revenir sur Terre.
La mission ExoMars elle-même fait des progrès. Les données actuellement collectées permettront aux scientifiques de cartographier la présence du méthane sur Mars et peut-être même d’identifier ce qui peut bien le produire.
« Il y a quelques semaines, nous avons commencé à prendre de nouvelles mesures, et les équipes travaillent d’arrache-pied pour extraire de nouvelles données sur le méthane », explique Håkan Svedhem, le scientifique du projet Trace Gas Orbiter. « Nous croyons que nous serons en mesure de présenter des résultats à ce sujet dans quelques semaines. »